-
Par editions le 28 Juillet 2013 à 18:31
LES DENTS DE LA MÈRE
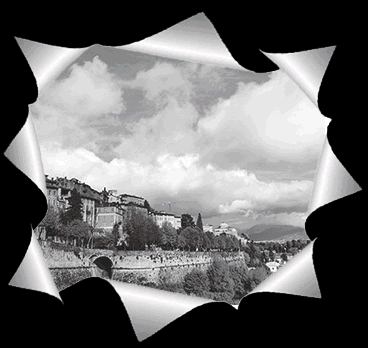
Etrangement je remarque la voiture d’Elisabeth garée dans notre grange ce qui me perturbe passablement.
Intrigué je descends retrouver maman qui est comme toujours devant ses fourneaux. C’est dingue ça, quelque soit l’heure du jour elle y est, lui supprimer sa cuisine et ses fleurs ce serait la priver de sa raison de vivre… Elle se retourne plus radieuse que jamais.
- Tu as bien dormi ! Ça fait plaisir…
- Plutôt oui, dis-moi, Elisabeth est là ?
- Oui, tu peux dire qu’elle m’a fait une belle surprise !
- Je m’en doute, mais j’aimerais comprendre ce qu’elle fait ici ?
Angela s’essuie rapidement les mains et s’assoit sur une chaise avec une expression désolée.
- Tout ça c’est à cause de moi, mon malaise a mis tout le monde en émotion.
- Bien évidemment, mais elle ne devait venir que ce week-end ?
- Elle m’a dit avoir pris trois jours et puis elle voulait me présenter son ami !
Du coup je m’assois aussi.
- Quel ami ? Elle est venue ici avec un mec ?
- Antonin, un garçon charmant comme tout et qui présente bien…
- Si elle nous l’amène ici, c’est que ce doit être sérieux ?
Ma douce mère retrouve son côté italien à l’ombre des clochers, elle lève un index en guise de précision.
- Attention, en tout bien tout honneur, je l’ai installée dans sa chambre, mais lui est dans la bleue ! J’attendais sa réaction mais il n’a pas fait d’histoire, c’est un garçon bien élevé…
Il est sûr que toute tentative de rencontres nocturnes est un échec assuré, les deux chambres sont à l’opposé l’une de l’autre et le passage oblige à faire grincer le plancher devant la chambre de maman. Ma fille cadette, de toute façon, savait bien qu’en invitant son petit ami il n’aurait pu en être autrement.
Je regarde ma mère verser mon café et me poser la tonne de victuailles pour un petit déjeuner classique malgré l’heure tardive.
- Où elle est en ce moment ?
- Elle a accompagné son petit ami dans le potager, elle doit le regarder travailler.
- Parce qu’il travaille ?
- Oui, il me ramasse quelques poireaux…
- Tu as demandé à ce garçon qui s’est tapé la route de faire un truc pareil ?
Elle a de la constance ma mère, en plus ma réflexion l’étonne, c’est limite si je n’ai pas été vulgaire.
- Dis-donc, s’il a des prétentions avec une de mes petites-filles, il doit avant tout savoir comment ça marche ici ! Non mais… Tout le monde participe, alors, s’il veut faire partie de la famille il y met du sien, c’est tout !
Je pense que ce garçon que je ne connais pas doit déjà être affranchi, quatre heure de route, probablement en partie de nuit et le voilà exilé avec son plumard au premier et équipé d’une fourche pour déterrer des poireaux… On fait plus accueillant.
- Et il y a longtemps qu’il est à l’ouvrage, ce brave garçon ?
- Deux bonnes heures, oh oui…
- Attends, tu as combien de poireaux dans ton potager ?
- Une douzaine, mais il fait aussi le paillage des arbustes, l’hiver va être rude…
Je crois rêver.
- Tu lui as aussi demandé de faire ça ?
Elle se retourne avec de grands yeux étonnés.
- Je t’en prie, ce n’est pas si fastidieux, comme le bois à ranger contre le mur aux figuiers, pour un gaillard comme lui, c’est trois fois rien !
Là, elle me scotche littéralement, j’en oublierais presque de finir mon café explosif.
- Tu plaisantes là… Tu ne lui as pas fait faire tout ça ?
- Je lui ai posé la question, il m’a répondu oui très gentiment…
- Tu sais bien qu’il ne pouvait pas dire non ?! Tu es vraiment gonflée.
- Je lui ai prêté les bottes de ton père, ses gants et un coupe-vent, quand même.
- Ah oui, tu as été généreuse et Elisabeth n’a rien dit ?
- Parce qu’elle devrait dire quelque chose ?
- Non, laisse tomber…
Je préfère ne pas discuter, elle ne comprendrait pas. Le monde, selon Angela, est celui de Bergamo du temps des moissons à la main et des marchés en carriole tirée par un cheval, des maïs pendus aux balcons ou des veillées devant l’âtre où l’on faisait griller, en famille, les châtaignes dans des poêles troués, il n’est plus cohérent avec celui d’aujourd’hui. Pour elle le temps s’est arrêté avec "les bonnes mœurs", la bonne éducation et la messe matinale. Elle refuse depuis de voir la société telle qu’elle est : éprise de libertés au sens large, en abstinence de responsabilité, perverse, égoïste et jouissive.
Donc l’autre pigeon a du s’offrir un effet bœuf en débarquant ici…
A ce propos, je vois à travers la fenêtre ma fille Elisabeth revenir avec un panier de poireaux sous un bras et son "andouille" de l’autre. Je découvre un grand gaillard qui la dépasse d’une bonne tête, large comme un convoi exceptionnel, tout en muscles, le visage carré planté sur un cou de taureau. La cravate en bataille, sous un coupe-vent qui s’envole, le pantalon de costume enfilé dans les bottes il est rouge pivoine malgré le froid saisissant, c’est dire qu’il en a bavé le pauvre gars.
En entrant, Elisabeth pose son panier et se jette dans mes bras.
- Papa ! Tu es levé… J’ai une surprise pour toi, je te présente Antonin.
Elle s’écarte pour que je prenne la main tendue de l’homme en sueur.
- Mon pauvre garçon, on ne vous a pas loupé…
- Non, ce n’est pas grave du tout, je suis heureux d’avoir rendu service à Angela.
- Taisez-vous malheureux, elle vous écoute !
- Et alors ?
Je lui pose une main amicale sur l’épaule pour l’installer au salon.
- Si vous voulez que votre séjour se transforme en enfer, continuez à dire que vous aimez rendre service, je vous garantis le renouvellement des peintures et quelques réparations de plomberie…
-
Par editions le 25 Novembre 2012 à 20:52
LA PISCINE

La cartoucherie
Non loin, se trouve "La Cartoucherie", un quartier tout aussi paisible mais plus vieux, avec des maisons marquées par l'outrage des ans. Comme son nom l'indique, il a été construit pour les ouvriers et cadres de l'usine. Il se compose donc, aujourd'hui, d'habitations à plusieurs étages bordant des rues étroites et de quelques vestiges de villas du troisième empire au prestige, depuis longtemps, disparu. C'est dans l'une d'elles que siège le Purgato de la ville. Le Purgato, est totalement inconnu des mortels et pour cause ! C'est un diminutif officialisé, depuis plus d'un siècle, de Purgatoire. Une sorte de commissariat de Police de l'au-delà. Chaque ville possède le sien. C'est ici que les âmes en cours de rachat sont incorporées pour se voir confier des missions purificatrices. Il n'y a aucune raison pour que l'agglomération de Launel échappe à la règle. La célébrité du Purgato de Launel est planétaire car c'est dans cette ville que se vénère le souvenir de Natacha Jammet, voyante célèbre de 1870, qui fit les grandes heures de la communication avec les esprits. Cartomancienne hors pair, elle maîtrisait tout, le pendule, l'écriture et les tables tournantes avec une adresse sans pareille et une efficacité redoutable. C'est bien simple, pour tous les esprits reconnaissants, elle est la Jeanne d'Arc du spiritisme, la Bernadette Soubirous de l'au-delà ! On ne compte plus les services rendus aux familles, aux veuves et parfois même à la police pour entrer en contact avec les défunts. Bref, elle était déjà, en quelque sorte, l'Internet des cimetières ! Elle a pourtant subi une fin assez pénible, assassinée dans la villa qu'elle venait de se faire construire à grands frais, elle a été enterrée secrètement par son bourreau dans sa serre. Son corps n'a jamais été retrouvé. Grâce à sa gentillesse et ses services rendus une vie durant, elle a obtenu un aller simple pour des cieux plus cléments. Restait son corps, gisant dans la serre de son ancienne maison… La villa Mauresque. Mais si le commun des mortels ignore où se trouve sa dépouille, il n'en est pas de même pour toutes les âmes tourmentées qui la vénèrent depuis plus d'un siècle et qui ont fait de cet endroit un lieu de culte et de pèlerinage. Par conséquent, il n'est pas question de toucher à ce lieu de recueillement et encore moins de laisser s'installer des casse-pieds ayant des idées rénovatrices.

L’origine de "La piscine" est une conjugaison de plusieurs sentiments.
Le déclic s’est fait par ma vie de famille avec ma femme et mes enfants où j’avais notamment remarqué l’incroyable lien qui pouvait unir une mère et son fils, la douceur des sentiments et leur complicité. Outre mon expérience personnelle, je me suis rendu compte, par la suite, que ce n’était pas un cas isolé.
Il me fallait donc l’écrire.
Pour le cadre j’osais la beauté ; passionné de troisième empire et des audaces architecturales du début du siècle il me fallait une villa comme l’on dit si couramment "Victorienne" ce qui revient au même. Car en fait, pour moi, c’est l’exemple type "du beau", un mariage d’élégance et de grandeur. Cette femme, séparée de son mari au sein d’une époque qui va gaiement vers le modernisme et le bio dégradable n’hésitera pas à faire le bon choix en achetant une maison qui a une âme plutôt qu’une quelconque habitation de lotissement.
Je la voulais femme de goût.
Enfin, en un temps où l’on s’endette pour acquérir une piscine, je démontre sa faiblesse, pour le bonheur de son enfant elle devra détruire une vieille serre, jadis une explosion de couleurs pour devenir un rectangle bleuâtre utilisé que deux mois de l’année. Ce choix douloureux financièrement, pour l’unique plaisir de son enfant, est a contrario de mauvais goût comparé à la villa et son jardin. J’aime ce genre de paradoxe.
Mais il ne faut pas que ce projet aboutisse car la beauté doit l’emporter.
Alors qui peut empêcher une telle folie si ce ne sont des forces surnaturelles et sous quel prétexte ?
La réponse est dans la Piscine.
Daniel Blanchard - Porthos
-
Par editions le 6 Mai 2012 à 21:45
LE BIFTON

C’est à la sortie du Bourg que les choses se compliquent, trois gendarmes attendent devant un fourgon et un petit gros s’avance au milieu de la route en levant une main autoritaire.
Dans un ensemble parfait, Blanchon et Locarini se penchent pour glisser les mains sous leur siège.
- C’est dingue ça ! On est au cœur de la banquise et on se fait taper les "fafs" par des archers !
- Restons calmes, souriants, avec l’insouciance et la bonhomie du touriste.
Une fois garée sur le côté, les trois gendarmes entourent la voiture avec naturel. Le petit gros se penche à la fenêtre et salue en souriant.
- Gendarmerie Nationale !
- Vous faites bien de le dire, avec vos nouvelles casquettes je vous aurais pris pour des cheminots.
- Je vois que Monsieur donne dans l’humour ? Alors rions ensemble et présentez moi vos papiers !
Locarini s’exécute de mauvaise grâce…
- Ceux de Monsieur aussi…
- Pourquoi, ce n’est pas le chauffeur ?
- Et moi je ne suis pas employé des postes ! Exécution je vous prie !
Blanchon tend son porte-cartes. L’Adjudant s’écarte et s’éloigne dans le fourgon pendant que ses hommes regardent avec attention le contenu de la voiture. Locarini observe son ami avec inquiétude.
- Il va interroger le sommier ce con ?
- En ce qui me concerne, je n’ai pas d’ardoise en cours…
- Moi non plus ! Mais c’est péjoratif tout de même, non ?
- A mon sens, il nous a repérés au restaurant l’autre soir…
L’adjudant revient, radieux, les joues rouges et la buée de sa respiration enjouée. Il se penche et rend les documents non sans parler avec une pointe d’ironie.
- Je vois que vous avez de quoi cultiver tout le pays là-dedans, vous avez l’intention de jardiner ?
- Vous savez ce que c’est, à la retraite on cherche à s’occuper, on bine de-ci, de-là…
- Non je ne sais pas ce que c’est ! Et vous avez l’intention de vivre de vos récoltes ?
Locarini se fend d’un sourire provocateur.
- On va faire dans le poulet !
- C'est-à-dire ?
- Le poulet chez nous c’est une passion, on l’égorge, on le plume et on le fait sauter…
- Je vois ! Tachez d’être habiles, il y a des poulets qui ne se laissent pas plumer facilement !
- Sauf les petits grassouillets, j’ai remarqué, ce sont les plus savoureux.
L’un des gendarmes parle à l’oreille de son chef, Louis Martineau glisse son regard vers le pare-brise.
- Vous pourriez me donner l’origine de ce trou ?
Locarini prend un air étonné.
- J’ai vu ça ce matin, un gravillon sans doute ?
- De la taille d’une bille ? Je vois, vous avez été agressés par une bande d’écoliers !
- Quand vous roulez, vous savez…
- Bien sûr, on peut heurter un peu de tout, des insectes et celui-là il devait être gros.
Locarini soupire avec une moue indécise.
- Un bourdon avec un casque intégral ?
L’Adjudant abandonne son sourire et se redresse en saluant machinalement.
- Foutez-vous de moi, croyez bien que ça ne va pas durer longtemps et, pour revenir sur la volaille, prenez garde que l’une d’elle ne vous étouffe… Allez, circulez, je vous ai assez vu !
La voiture repart sur la route gelée.
- Quel con !
- Tout de même, cette provocation gratuite ne va pas nous en faire un ami.
- Tu as déjà vu un mec de chez nous sous la douche avec un perdreau toi ?
Blanchon se retourne et regarde par la fenêtre arrière.
- En attendant, avec les gestes qu’il fait, c’est un petit nerveux, il va falloir faire gaffe !
- Mais arrête de te faire de la bile, nous sommes clairs, non ?
- Il ne faudrait pas qu’il s’intéresse trop à nous, on ne peut pas avoir des yeux partout !
-
Par editions le 6 Janvier 2012 à 20:06

Je ne maîtrise pas top mes pensées encore, mais ce n’est pas si désagréable. Nous reprenons donc la direction de la gare. Peu après, nous quittons la circulation et la foule pour retrouver la grande rue bordée de platanes et la gare, où le train attend, docile. Quelques voyageurs pressent le pas, suivis de porteurs qui poussent leur diable, alors que d’autres, déjà installés, attendent le départ aux fenêtres. Un haut-parleur grésille, « Villeport, quai A, départ dans cinq minutes », poussant les retardataires à s’engouffrer dans les wagons. Nous pénétrons dans un compartiment. Eve cale le bouquet sur les filets à bagage et s’installe en face de moi, souriante. Par la fenêtre, je vois la casquette blanche du chef de gare. Un coup de sifflet strident retentit. Lourdement, le train s’ébranle. C’est le départ.
Je retrouve notre station avec plaisir, puis le Taxi, la forêt, la bifurcation sur l’ancienne voie romaine et, enfin, notre chez nous, avec soulagement…
Eve s’installe sur la terrasse, le temps de préparer quelques rafraîchissements. Je reste assis face à l’immense plaine en contrebas, qui s’engourdit sous le soleil couchant avec les premières lumières de Villeport. Il ne fait pas encore nuit, ce n’est que la fin de la journée, ce moment précis où le jour persiste tout en se laissant aller aux premiers abandons des vallées les plus profondes et aux contreforts opposés à l’Ouest en feu. C’est à ce moment précis que je ressens une curieuse sensation, tout d’abord légère, celle d’un malaise naissant. Je m’inquiète, mais il disparaît et je me rassure à nouveau. Le temps de me retourner vers Eve, qui apparaît avec un plateau, et le mal revient. Il me reprend et, cette fois, avec plus de force, comme une angoisse étrange qui me creuse le ventre et qui m’affole.
La jeune fille pose le plateau sur la table et se précipite vers moi. Je la regarde s’agenouiller près de moi et me poser sa main sur le visage.
« Rony ! Qu’est-ce qui se passe ? Tu n’es pas bien ? Tu as le visage crispé ! »
Je ne peux pas répondre, j’en suis incapable, mon cerveau panique de trop. J’ai peur, j’ignore pourquoi, mais j’ai peur au point d’étouffer. Je parviens à désigner du regard l’horizon, il s’assombrit terriblement, en rouge sang, avec une sorte d’auréole qui s’élargit dans le ciel, trouée en son centre. A croire qu’une violente tempête s’annonce ! Eve se retourne et pousse un cri.

-
Par editions le 30 Décembre 2011 à 13:44

Philippe-Jacques de Loutherbourg (1740 - 1812)
Aux origines de la morale, de celle que j’ai adoptée.
On peut naitre dans n’importe quel pays du monde, du plus riche au plus pauvre, du plus corrompu au plus prude, on n’en ressentira que les échos de notre cœur et rien d’autres.
La sensibilité ne se discute pas, c’est un don, un cadeau brûlant et redoutable.
Ne pas admettre que depuis des millénaires l’homme est attaché à sa famille, son clan, sa contrée, son pays et de façon plus universelle sa croyance, est une hérésie. Il s’agit là d’un équilibre naturel, indispensable, incontournable si l’individu veut progresser et s’épanouir. Ainsi, cet équilibre repose sur sa première vocation, créer une famille, un homme et une femme afin d’avoir des enfants pour transmettre et assurer la continuité.
Pourquoi refuser à l’homme ce que l’on prête volontiers au monde animal dont la protection est très en vogue, si ce n’est dans les faits au moins par l’esprit ?
Qu’avons-nous de plus que nos aïeux, si lointains soient-ils, pour prétendre être si différents de nos jours ? D’où vient cette incroyable prétention de se dire qu’en trente ou quarante ans nous avons bien mieux progressé que ces derniers milliards d’années ? Rien. Quelle stupidité ! Nous sommes à l’identique et encore, si ce n’est même moins bons ! Je ne vois pas de différence de comportement entre un jeune Babylonien, Troyens, Athénien, Celte, Romain, Gaulois et un étudiant européen d’aujourd’hui. Qu’il soit sage ou contestataire, véritable brûlot de banlieue, il n’y a absolument aucune différence surtout dans le désœuvrement et l’ennui.
Ils sont tous identiques.
Croyez-moi, leurs jeunes ainés, inconnus et disparus dans l’indifférence des mémoires ont eu les mêmes pensées soporifiques, les mêmes comportements, et pour certains la même violence que notre jeunesse actuelle qui n’a plus rien de vert, si ce n’est le verbe, même si ce dernier est très limité.
Nous assistons en effet aux mêmes conneries que celles de bon nombre de jeunes dans nos bonnes villes moyenâgeuses, pourtant sous l’emprise d’une morale toute chrétienne... agressions, dégradations, «apéros géants» dans les cimetières et même affrontements entre étudiants et policiers, le guet, face à ces rejetons protégés en leur temps par l’Eglise. Ce dernier point est-il une particularité qui mérite d’être notée dans les progrès de notre société ? Non, ce serait plutôt le contraire.
Pas de changement, donc, c’est toujours le même topo et pour le plus grand malheur de leurs peuples respectifs.
 Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Osez l'Evasion




